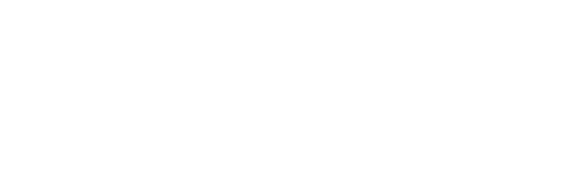LA TSANTSA
 Le Musée d'Histoire naturelle et d'Ethnographie de Colmar conserve en ses murs une tsantsa, une tête humaine réduite selon une pratique rituelle des peuples Shuar, Achuar, Huambisas et les Aguarunas d’Amazonie équatorienne et péruvienne.
Le Musée d'Histoire naturelle et d'Ethnographie de Colmar conserve en ses murs une tsantsa, une tête humaine réduite selon une pratique rituelle des peuples Shuar, Achuar, Huambisas et les Aguarunas d’Amazonie équatorienne et péruvienne.
L’entrée au musée d’un objet permet de le figer et de le préserver de l'oubli. Il perd alors son statut d'artefact en usage pour devenir pièce de collection, témoin du passé et élément d’un patrimoine à conserver. Cette transformation soulève des interrogations fondamentales. Que conserve-t-on réellement : l’objet matériel, son histoire ou sa signification culturelle ? Privés de leur contexte géographique, historique et social, les objets ethnographiques se trouvent parfois en rupture avec leur fonction d'origine. En l'absence d'information sur leur utilisation, leur symbolique et sur les conditions de leur collecte, des réinterprétations parfois éloignées de leur sens initial peuvent naître.
Représentation et déconstruction des stéréotypes
Offerte au musée vers 1940 par le Docteur Stoll d'Haguenau, cette tsantsa fut exposée jusqu'en 2024 sous l’étiquette « Tête d’Indien Jivaro ». Utilisée dès le 16e siècle par les Espagnols pour désigner indistinctement les populations qu'ils jugeaient sauvages ou dépravées, l’appellation Jivaro est actuellement rejetée par les communautés concernées et tend à disparaître.
La tsantsa est liée à des rituels religieux et guerriers spécifiques, inscrits dans une vision du monde où l’esprit de l’ennemi était capturé pour transmettre son pouvoir et protéger la communauté. Longtemps exposée comme curiosité dans de nombreux musées occidentaux, la tsantsa a renforcé une image exotisante et déshumanisante des peuples amazoniens. Recontextualisée, elle peut permettre de déconstruire les représentations coloniales, d'ouvrir une réflexion sur des cosmologies peu connues et d'enrichir les savoirs sur les rapports que chaque culture entretient avec la mort, la violence et le sacré.
Identité et authenticité
Les tsantsas sont des restes humain. L’identité de cet individu, son statut social et les circonstances de sa mort sont inconnus. De plus, certaines estimations indiquent que jusqu’à 80 % des tsantsas conservées dans les musées européens pourraient être des imitations réalisées à des fins commerciales. L’authenticité même de cet tsantsa reste donc incertaine. Toutefois, même en l’absence d'informations et de certitudes quant à son identité ou son authenticité, cette tsantsa bénéficie d'une place de choix au sein du nouveau parcours permanent. Sa présence permet d'éclairer les questionnements qui traversent les musées aujourd'hui, de questionner la frontière entre corps et artefact, d'interroger les notions de vérité et de mémoire dans les collections, et de stimuler une conscience critique chez les publics.