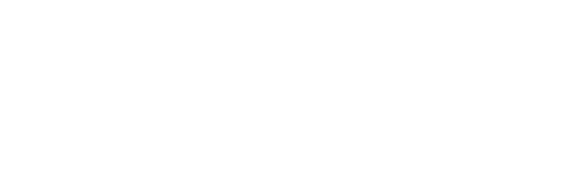LES LIONS DU MUSÉE
La Société d’Histoire naturelle et d’Ethnographie de Colmar compte parmi ses collections deux spécimens de lions acquis durant la seconde moitié du 19e siècle. Bien que des doutes subsistent quant à leur provenance géographique, ils sont les témoins d'une espèce à protéger.
Des informations partielles ou contradictoires
Les collections anciennes, comme celles de la Société d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie de Colmar, ont subi différentes approches de conservation et des épisodes plus ou moins mouvementés, notamment lors des grands conflits. Aussi, les informations liées aux spécimens peuvent avoir été réinterprétées, falsifiées, égarées ou définitivement perdues. C’est le cas pour les deux lions acquis dans les années 1870.
Le premier spécimen, actuellement exposé au musée, a été acquis par la Société en mars 1870, grâce à un don du Muséum national d’Histoire naturelle à Paris. L’acquisition de ce spécimen est documentée en 1872 dans les comptes rendus de la Société, bien qu’ils n’en précisent pas l’origine géographique. Les deux versions manuscrites du catalogue de la collection de Mammifères, rédigées à l'époque par Charles-Frédéric Faudel, précisent tout de même que ce spécimen serait un mâle juvénile d’environ deux ans originaire d’Algérie.
Le second spécimen, aujourd'hui conservé dans les réserves, a été acheté 200 francs en mai 1874 à un Bâlois du nom de Hübscher, comme mentionné dans le compte-rendu de la Société de 1876. D’après le second catalogue manuscrit de Faudel, le spécimen serait un mâle adulte originaire d’Asie Mineure, possiblement de la région de Guzerat en Inde. Ces informations sont contredites quelques années plus tard. Dans l’inventaire imprimé des Mammifères des collections de la Société publié en 1894 par Gustave Schneider, les deux lions sont mentionnés comme étant un mâle et une femelle provenant d’Alger. Des notes au crayon de papier, très probablement rédigées par Gustave Schneider dans le premier catalogue de Faudel, laissent à penser qu’il avait un doute sur la provenance géographique du spécimen de 1974 et sur le sexe du spécimen de 1870. En effet, les pratiques de naturalisation de l’époque amènent couramment à retirer les attributs sexuels. Par ailleurs, s’agissant d’un individu juvénile, sa taille et sa crinière sont peu développées. L’ensemble de ces caractères morphologiques liés à l’âge de l’individu et à sa naturalisation a probablement conduit Gustave Schneider à y identifier un individu femelle, et ce, malgré les indications originales.
Une histoire mouvementée
La suite de l’histoire n’en est pas moins banale. Les deux lions disparaissent des collections de la Société à la fin de la seconde guerre mondiale, période pendant laquelle les collections ont été dispersées dans diverses institutions colmariennes. Bien que la Société rassemble ses collections dès les années 1950, il faut attendre près de trente années pour retrouver la trace des deux lions à travers un inventaire d’une collection privée rachetée par la Ville de Colmar en 1987. Les spécimens sont alors entreposés dans des locaux appartenant à la Ville. De 1993 à 1997, ils sont exposés dans une vitrine au rez-de-chaussée du Musée du Jouet à Colmar puis stockés dans ses réserves jusqu’en 1999. Cette même année, sous l’impulsion de Michel Glénat, alors responsable administratif du Musée du Jouet, est conclu un accord tripartite de restitution entre la municipalité, le Musée du Jouet et la Société.
Toutes ces vicissitudes n’ont pas été sans conséquence sur l’intégrité des deux spécimens. Une campagne de restauration sur le spécimen d’Asie Mineure a donc été entreprise en 2003, menée par Dominique Nitka, taxidermiste au Musée Zoologique de Strasbourg.
Des études approfondies à mener
Malgré cette plongée dans les archives, aucune information précise n’est disponible sur les origines géographiques régionales de ces spécimens, ni sur les dates et auteurs des prélèvements, ni sur les conditions précises de naturalisation et de montage.
En 2010 des photographies des deux lions ont été transmises à Velizar Simeonovski, zoologiste au Field Museum de Chicago et spécialiste des espèces disparues. D’après son expertise, et sur des critères uniquement morphologiques, les deux spécimens ont été identifiés comme étant des lions mâles mais leur morphotype serait plus proche de celui des lions d’Asie. Cette hypothèse questionne évidemment sur l’origine géographique du spécimen provenant d’Alger mais nécessite d’être confrontée à une approche moléculaire.
D'autre part, le morcellement des populations de lion sur un vaste territoire a conduit les scientifiques à distinguer jusqu’à huit sous-espèces. Aujourd’hui, deux sous-espèces seulement sont admises : Panthera leo persica (Meyer, 1826) pour les populations du sous-continent indien et Panthera leo leo (Linnaeus, 1758) pour les populations africaines. Si nous tenons pour exactes les origines géographiques fournies lors de l’acquisition des deux spécimens, les noms applicables sont respectivement Panthera leo leo pour le spécimen algérien et Panthera leo persica pour le spécimen d’Asie Mineure. Le Lion de Barbarie ou Lion de l’Atlas est le nom vernaculaire applicable pour le spécimen algérien tandis que le lion provenant d’Asie peut être nommé Lion de Perse ou Lion d’Asie.
Un travail récent de phylogéographie sur l’ensemble de l’aire de distribution historique du lion, fondé d’une part sur des individus vivants et de collections et d’autre part sur des marqueurs moléculaires, contredit cette division sous-spécifique. En effet, Bertola et al. (2016) identifient deux grandes lignées monophylétiques, dont l’une regroupe les lions d’Asie, d’Afrique du Nord, de l’Ouest et du centre, alors que l’autre rassemble les lions d’Afrique du Nord-Est et du Sud. D’après ces auteurs, les lions d’Asie et d’Afrique du Nord devraient être désignés par le même nom.
Une espèce emblématique, des spécimens patrimoniaux
Le lion est aujourd’hui présent sur un territoire de plus de 3,4 millions de km² et sa population mondiale est estimée à 35 000 individus. Il est présent en Afrique subsaharienne et marginalement en Inde dans la forêt de Gir sur un maigre territoire de 1 400 km2. Il a été éradiqué de tout le bassin méditerranéen dès l’Antiquité, de l’Asie Mineure au cours du 19e siècle et, concernant l’Afrique du Nord, le dernier lion de l’Atlas a été tué dans les années 1940.
Si les deux spécimens proviennent effectivement de ces deux régions, ils constituent alors un fort patrimoine muséographique et scientifique. Ils sont en effet les derniers témoins de la présence de l’espèce sur un vaste territoire mais aussi les victimes directes d’un massacre qui continue sous d’autres formes. Aujourd’hui, les menaces qui pèsent sur l’espèce sont les tirs de protection, la baisse significative du nombre de proies, la destruction et la fragmentation de ses habitats et le braconnage pour le commerce illégal.
Ils sont également de précieux spécimens pour la recherche fondamentale car le patrimoine génétique qu’il est possible d’extraire de leurs tissus peut encore révéler des informations sur le passé de l’espèce, notamment pour les aires naturelles où l’espèce est aujourd’hui éteinte.